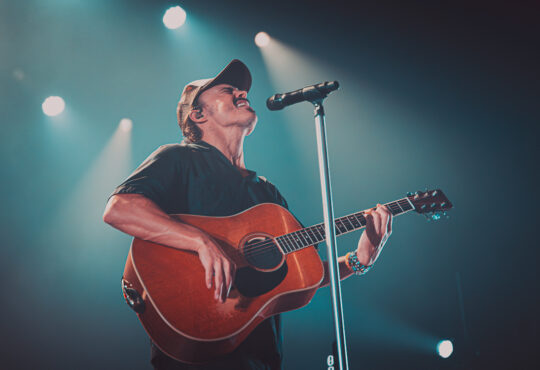Le moment était idéal pour réviser ses classiques du cinéma d’horreur en ce vendredi soir, dommage que le calendrier n’ait pas offert un vendredi 13, l’ironie aurait été parfaite.
La Salle Pleyel, elle, affichait complet. Un décor pour le moins inhabituel pour une affiche metal : fauteuils impeccables, pit minuscule, deux étages de places assises… Un écrin taillé pour le classique ou le jazz, soudain confronté à l’électricité d’un public venu pour tout sauf sagement applaudir. Le contraste donne à la soirée une saveur étrange et délicieusement décalée, entre prestige feutré et chaos parfaitement chorégraphié.
Cette date parisienne s’inscrit dans la tournée européenne ambitieuse A Work Of Art Tour 2025 d’Ice Nine Kills, pensée comme une expérience scénique totale, où la production visuelle occupe autant d’espace que la musique.
Mais avant que le spectacle horrifique ne commence vraiment, deux groupes prenaient soin de lancer la soirée : d’abord Creeper, puis The Devil Wears Prada.
Creeper – Esthétique vampirique et premier circle pit
CREEPER ouvre la soirée avec son esthétique immédiatement reconnaissable : silhouettes noires, look rock et maquillage blanchâtre sculpté sur les visages, façon vampires romantiques sortis d’un roman gothique de 1890 revisité par un styliste moderne. Le frontman, Will Gould, joue à fond le rôle du crooner ténébreux, présence théâtrale, gestes millimétrés et voix sombre. On pense parfois à Ghost dans la manière dont ils installent un imaginaire visuel cohérent, ou aux 69 Eyes dans ces sonorités goth rock sombres et élégantes qui s’infiltrent dans les structures punk de leurs morceaux.
Les titres s’enchaînent avec un équilibre précis entre énergie rock et esthétique théâtrale. Les refrains portent bien, les guitares sont nettes, et surtout : le groupe parvient à déclencher le premier circle pit de la soirée. Dans une salle aussi hiératique que Pleyel, voir un mouvement comme celui ci se former dès la première partie relève presque du miracle. Le pit n’est pas immense, certes, mais suffisamment vivant pour installer une ambiance avec quelques dizaines de personnes ravies d’être enfin autorisées à secouer les murs feutrés de la salle.
Creeper maîtrise son identité, son rythme et son rapport au public. Une entrée en matière soignée, gothique et parfaitement calibrée pour faire basculer la soirée dans une esthétique sombre sans la rendre pesante.
The Devil Wears Prada – Contraste des voix et interruption inattendue
Après le goth rock saturé de Creeper, THE DEVIL WEARS PRADA arrive sur scène avec une proposition plus brute, plus directe. Le duo vocal emblématique du groupe fonctionne immédiatement : l’un délivre un scream percutant, l’autre apporte une ligne mélodique plus douce et aérienne, renforcée par leurs styles vestimentaires totalement opposés, l’un plus rock, l’autre en sweat et pantalon de costume. Cette tension sonore et visuelle donne aux morceaux un relief immédiat, transformant les attaques de guitare en vagues successives qui montent progressivement dans la salle.
L’auditoire commence à chauffer pour de bon. Le pit se densifie, les mouvements sont plus francs, et l’on sent une vraie montée en énergie. Pourtant, les balcons et les places assises restent encore un peu immobiles.
Le set de The Devil Wears Prada se déroule correctement, jusqu’à cette rupture nette : le concert s’arrête dix minutes avant la fin, lorsque l’un des chanteurs disparaît, sûrement a cause d’un malaise. Les pompiers interviennent rapidement en loge, la salle reste silencieuse, attentive, respectueuse. Le set ne reprendra pas.
L’audience applaudit en guise de soutien, rappelant qu’en pleine tournée européenne, la fatigue peut commencer à se faire sentir.
Entracte et montée dramatique
Il est maintenant temps que la scène se prépare pour la tête d’affiche. Les techniciens opèrent avec efficacité, les décors changent. Le micro emblématique de Spencer Charnas est installé au centre de la scène, comme un totem, presque une pièce maîtresse de la scénographie. Les écrans commencent à s’allumer : silhouettes menaçantes, bribes de films d’horreur, visages masqués, oscillant entre cinéma gore et esthétique macabre. L’attente monte dans la salle; il ne s’agit plus seulement d’un concert, mais d’un spectacle immersif.
Ice Nine Kills – Le spectacle d’horreur en live
Lorsque les lumières se baissent et que le plateau se dévoile, la transformation est totale. Les écrans au fond de la scène projettent les premiers extraits, le micro signature de Spencer trône au centre, et les objets scéniques laissent deviner que la soirée ne sera plus seulement musicale, mais totalement théâtrale.
ICE NINE KILLS aborde chaque concert comme un spectacle cinématographique. Ce n’est pas simplement un groupe qui joue des morceaux : c’est une troupe qui met en scène une série de tableaux inspirés des plus grands films d’horreur de l’histoire. Chaque morceau devient une scène. Chaque scène a son propre meurtre rituel, ses acteurs, ses accessoires, son décor mouvant.
Dès les premières minutes, Spencer enfourche son rôle de maître de cérémonie sanguinaire. Costume impeccable, regard espiègle, énergie constante : il ne cesse d’alterner entre chant, jeu d’acteur, manipulation d’accessoires et… homicides artistiques. Car oui : à chaque morceau, ou presque, un membre du crew est “tué” sur scène dans une mise en scène gore et volontairement exagérée. Quand on pense à toutes les dates qu’ils doivent faire, ils doivent vraiment aimer ce qu’ils font…
“Hip To Be Scared”, évidemment au programme, constitue un moment marquant et attendu de cette première partie du show. Gestes précis, chorégraphie au cordeau et hache iconique. Spencer endosse son rôle de Patrick Bateman avec un sérieux presque inquiétant, arborant le célèbre “raincoat” pour rejouer la scène culte d’American Psycho. Il porte les coups avec un détachement étudié, sans effusion de sang – un choix qui, paradoxalement, renforce encore la dimension théâtrale de la séquence.
D’autres scènes mythiques sont recréées, comme la célèbre “shower scene” de Psychose, avec Spencer restant le meurtrier principal. “It Is The End”, inspiré du film It, voit un enfant sur scène jouer le rôle de Georgie, sa main arrachée par Spencer en Pennywise dans un tableau effrayant et maîtrisé.
Le groupe excelle dans le contraste. Dans certains morceaux, la musique peut être étonnamment légère, presque ensoleillée, alors que les images projetées sur les écrans sont sombres, morbides, crues. Le moment marquant : “Walking On Sunshine”, joué pendant que les vidéos montrent des scènes horrifiantes. Ice Nine Kills joue avec les attentes du public, avec les clichés de l’horreur et de la pop.
Dans cette trame visuelle, les cuivres (saxophone, trompette) prennent une place inattendue mais essentielle. Parfois discrets, parfois puissants, ils enrichissent l’arrangement et donnent du relief à l’ensemble, renforçant l’impression d’une bande-son de cinéma d’horreur, parfaitement synchronisée aux scènes.
Malgré la configuration atypique de Pleyel, le son est de très bonne qualité : guitares, basse, batterie, voix et cuivres sont tous parfaitement audibles. L’assemblée perçoit aussi bien les instants théâtraux que les breakdowns plus lourds : rien n’est noyé, permettant de profiter pleinement de la dimension narrative du show.
Sur scène, Spencer Charnas joue son rôle avec conviction : leader charismatique, personnage de film d’horreur et maître de cérémonie cruel. Les figurants se déplacent, meurent et reviennent dans une chorégraphie parfaitement réglée. L’ensemble ressemble à un spectacle répété et millimétré, chaque moment conservant une énergie “vivante“.
L’interaction avec l’assistance est constante : Spencer sollicite les fans, appelés psychos, pour des réactions, cris et applaudissements. Le pit, petit mais intense, vibre aux moments clés. Les balcons, initialement distants, se laissent peu à peu emporter par la puissance visuelle et musicale du show.
Après le set, le public conquis scande un rappel et Ice Nine Kills revient deux morceaux avec pour titre final, la thématique de Terrifier. La scène présente Art The Clown manipulant un bébé accroché à un cordon ombilical, tableau à la fois grotesque et inquiétant. Progressivement, ce personnage “remplace” chaque membre du groupe un à un, concluant le show de manière symbolique, humoristique et marquante. Le public est conquis : c’est l’aboutissement d’une narration bien orchestrée.
Creeper a installé une atmosphère gothique travaillée, The Devil Wears Prada a apporté une énergie plus directe, et Ice Nine Kills a livré une performance scénique précise et soignée. Une soirée cohérente et singulière, marquée par une identité forte et une mise en scène aboutie, qui s’impose davantage par son sens du détail et de l’ambiance que par la recherche de perfection brute.